Information sur la transfusion sanguine
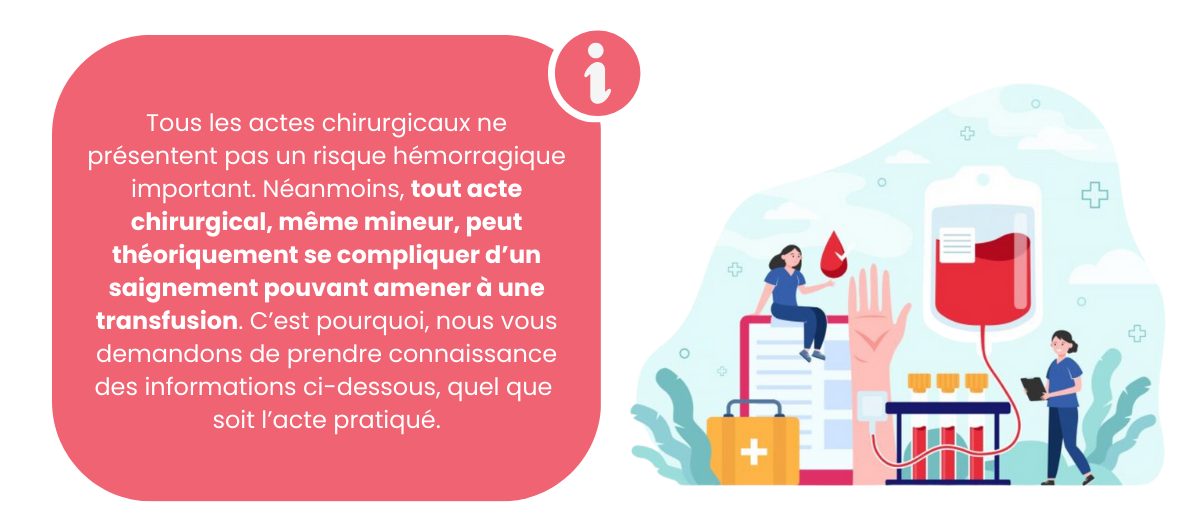
Si votre état de santé nécessite, sans autre alternative, une transfusion sanguine, cette page est destinée à vous informer sur les bénéfices et les risques de la transfusion.
Si vous refusez la transfusion sanguine, vous devez en informer le plus tôt possible en consultation le chirurgien et le médecin anesthésiste. Cela donnera lieu à une discussion au décours de laquelle le médecin prendra en compte vos souhaits et vous donnera une information claire et loyale sur l’attitude médicale qui sera adoptée.
La transfusion sanguine est un acte médical réalisé sur prescription. Elle peut vous concerner en cas de manque de globules rouges, de plaquettes ou de facteurs de la coagulation. C’est un traitement qui a largement fait preuve de son efficacité pour de très nombreux patients.
La transfusion sanguine répond à des normes règlementaires tant au niveau national qu’européen. Elle est donc régie par de nombreux textes de lois ou décrets et aussi des recommandations issues de la communauté médicale et des autorités sanitaires (2012, 2014, 2015 : recommandations de la « Haute Autorité de Santé » et de « l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé », respectivement sur la transfusion de plasma, de globules rouges et de plaquettes).
Si votre état nécessite un acte chirurgical comportant un risque hémorragique majeur, vous êtes susceptible d’être transfusé(e). Lors de la consultation d’anesthésie, le médecin définira, avec votre accord, une stratégie transfusionnelle adaptée à votre état de santé. Dans l’éventualité d’une transfusion de globules rouges, il vous informera notamment sur le « taux d’hémoglobine seuil » en dessous duquel vous êtes susceptible d’être transfusé(e).
La transfusion sanguine peut survenir pendant l’opération alors que vous êtes anesthésié(e). La décision est prise (le bénéfice attendu est supérieur aux risques encourus) car le saignement est très important et/ou mal toléré (chute importante de tension artérielle par exemple). Vous serez informé(e) de cette transfusion dès votre réveil.
Les risques encourus sont rares et le plus souvent sans gravité (urticaire, réaction fébrile).
En raison des progrès de la médecine et des technologies, le risque de contamination virale par les virus des hépatites, le virus du SIDA (VIH) ou d’autres virus est devenu très rare.
Que faire après une transfusion ? La recherche d’une contamination virale n’est plus effectuée depuis 2006. En revanche, la recherche d’anticorps anti-érythrocytaires (RAI ou RAE) 4 à 12 semaines après la transfusion est vivement recommandée afin de sécuriser une future transfusion.
Si vous avez été transfusé(e), à votre sortie de l’hôpital, il vous sera remis :
– un document précisant la date, la nature et le nombre de produits sanguins transfusés,
– une ordonnance pour rechercher les anticorps anti-érythrocytaires.
Un compte rendu d’hospitalisation mentionnant votre transfusion sera aussi adressé à votre médecin traitant.
Il est important de conserver ces documents et de les montrer en cas d’hospitalisation, de nouvelle
transfusion ou de changement de médecin traitant.
Information élaborée par la Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) – 2020.

